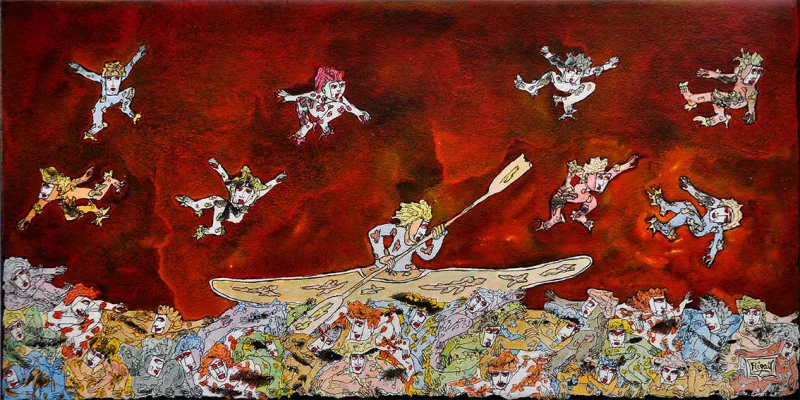Comment décrypter ces photos de PhilipKa :
Les fleurs viennent de Normandie, où l’artiste les a cultivées ou cueillies, tout en citant Montaigne : “Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs”.
Les bouquets sont de sa composition.
Le thème n’est pas reconnu comme ”nature morte”, terme que l’artiste récuse pour privilégier l’appellation anglaise de “still life” ou “vie silencieuse”, une vision qui souligne la présence latente du vivant dans l’inanimé, aussi perçue comme une forme de calme introspectif, d’arrêt du mouvement, voire de méditation… Il immortalise la ”merveille de la nature, belle, fragile, flamboyante et éphémère”. Une façon de montrer qu’il y a de la beauté en toute chose et de partager cet optimisme.
Le style est présenté comme clair-obscur ou “ténébrisme en fleurs”. PhilipKa se plaît à jouer avec les lumières et les ombres : les volumes qui se détachent en pleine lumière sur les ténèbres qui les environnent rappellent en effet le ténébrisme du Caravage.
Les influences sont multiples. Ces portraits de fleurs s’inspirent bien sûr des natures mortes et des portraits des maîtres flamands et italiens. Mais ils assument leur modernité, au carrefour des pays qui ont façonné l’artiste : le Togo paternel, pour la sensualité et le mouvement, la Russie maternelle, pour la poésie et la finesse, et, pour la légèreté, la France où l’artiste a fini par s’établir, tout d’abord comme juriste puis comme photographe professionnel.
Les photos sont généralement tirées en 3 exemplaires pour les plus grands formats (1m x 1.5m et plus) et en 7 pour les autres.
Les œuvres de PhilipKa ont été présentées en France et aux Etats Unis.
Son grand bouquet carré a remporté le premier prix du concours « Blooming » Cherrydeck Creators Awards.